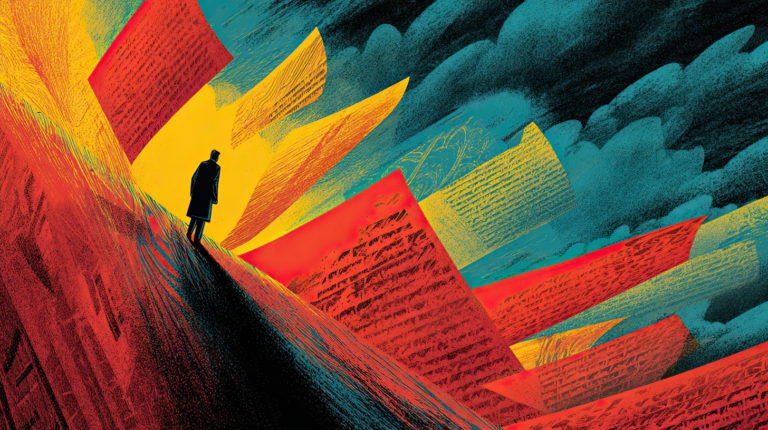Gaza à l’antenne, Lausanne à l’épreuve
Les images de la faim ont rompu la digue de la première partie de soirée en Suisse et la périphrase a rendu les armes. Au même moment, Lausanne traverse sa propre épreuve entre force publique et citoyens. Je rapproche ces deux plans sans raccourci, avec méthode et avec la seule loyauté qui tienne, celle des faits.
« La faim est un crime »
– Eduardo Galeano –
Ce qui a changé dans le journal télévisé
Pendant des mois, le mot famine a été contourné. On parlait de crise humanitaire, d’accès entravé, de convois imaginaires. Puis, soudain, dans les JT suisses, les visages cessent d’être des chiffres et l’os apparaît sous la peau. Ce n’est pas un sursaut de bravoure, c’est l’effet d’un seuil. Quand les organismes compétents nomment ce qui arrive, l’édition ne peut plus se protéger derrière les périphrases. La télévision n’invente pas le réel, elle l’admet tard, trop tard.
Je ne cherche pas à crucifier les rédactions. Je veux comprendre le mécanisme. Le seuil opère toujours de la même manière, rapport technique, validation institutionnelle, disponibilité d’images, puis diffusion. La morale suit, éprouvée, comme quelqu’un qui arrive à un incendie avec un verre d’eau. J’ai trop souvent vu en Europe ce manuel de la prudence infinie qui confond neutralité et anesthésie. Le lexique rassure les consciences, il ne nourrit personne.
Chronologie minimale vérifiable
Fin août, des documents publics signalent que la situation alimentaire à Gaza dépasse la simple urgence. Dans la même fenêtre temporelle, les principaux journaux du pays consacrent des blocs entiers à des images dures, enfants aux yeux creusés, services hospitaliers exsangues, files pour un pain qui ne suffit pas. En parallèle, à Lausanne, une poursuite policière se termine par la mort d’un adolescent, deux nuits de colère secouent un quartier populaire, la Municipalité annonce la suspension d’agents après la découverte de messages discriminatoires dans des groupes internes et promet une enquête avec communication régulière. Le calendrier se superpose, l’écran montre au loin ce que le pays tente de comprendre tout près.
Je tiens une règle simple, ce que je ne peux pas prouver, je le range du côté de l’hypothèse. La coïncidence temporelle est un fait. L’intention éditoriale ne l’est pas. Sans documents internes, je refuse de bâtir des conspirations de programmation. Je préfère compter les minutes d’antenne, titre par titre, séquence par séquence, puis mettre ces courbes face à face.
Lausanne, police et confiance publique
Une ville n’est pas une abstraction. Ce sont des familles, des commerces, des écoles, un réseau de liens fragiles qui s’effondre quand une mort violente traverse le quotidien. La réponse des autorités doit être transparente, rapide, vérifiable. Suspendre des agents n’est qu’un premier geste. La confiance ne se décrète pas, elle se reconstruit. On ne répare pas un lien civique avec des communiqués calibrés. On le répare avec des faits, des délais tenus, des comptes rendus accessibles, des décisions qui laissent une trace lisible.
Je me méfie de la phrase rituelle qui promet un retour au calme. Sans clarté procédurale, le calme signifie silence imposé. Je veux savoir qui a ordonné quoi, quand la décision de poursuivre un mineur a été prise, quels protocoles ont été appliqués, quels enregistrements existent, qui protège les preuves, quel est le calendrier de l’enquête administrative et pénale. Je veux aussi que cette information soit publique. Non pour humilier la ville devant sa propre audience, mais parce qu’une autorité qui retient l’information fabrique de la rumeur, des récits concurrents, puis de la haine.
Neutralité suisse, procédure et lenteur morale
La neutralité est un point de départ juridique. Elle n’est pas un refuge éthique. Sur la scène internationale, la formule est connue, accès humanitaire sans entraves, cessez-le-feu, protection des civils, libération des otages. Tout cela est juste dans la lettre et pauvre dans le temps. Quand arrive la qualification de famine, les corps ont déjà commencé à se consumer depuis des mois. Devant l’écran, cette lenteur morale fabrique une illusion d’équilibre qui ne protège personne.
Dans l’espace interne, la même esthétique du processus confond trop souvent transparence et formalisme. On ouvre des dossiers, on annonce des audits, on publie des résumés techniques qui n’éclairent pas l’essentiel. Que s’est-il passé, qui répond, comment répare-t-on. Une neutralité bien comprise exigerait l’inverse, presser la vérité pour que le droit s’appuie sur du solide et que le deuil puisse se nommer sans se travestir.
Double écran, même point aveugle
Le pays qui se regarde dans le monde à travers sa télévision aperçoit une famine et se décide à prononcer le mot qu’il évitait. Le pays qui se regarde à l’intérieur préfère parler de calme et de procédures. Dans les deux cas, le réel force le cadre jusqu’à le briser. Il n’y a aucune grandeur dans ce constat tardif, il y a de la honte. La télévision enseigne quand elle ne peut plus cacher. La ville apprend quand elle ne peut plus nier.
Je ne fais pas du journalisme de slogans. Je travaille avec une méthode. Je prends les minutes exactes consacrées à Gaza dans les tranches centrales des journaux télévisés de la semaine. J’inscris à quelle minute entrent les sujets, quelle durée ils occupent, quels témoignages ils contiennent et quels termes ils emploient. Je fais la même opération avec la couverture de Lausanne en distinguant l’événement de la suite institutionnelle. Avec ces données, je trace des courbes. Lorsque la crudité des images sur Gaza augmente, la visibilité de Lausanne diminue-t-elle ou progresse-t-elle en parallèle. La conclusion ne sera pas idéologique, elle sera empirique.
Méthode de vérification et exigences publiques
Je ne me contente pas d’une intuition. Il me faut des documents. Je demande aux chaînes leur politique écrite sur la diffusion d’images de mineurs en contexte de famine et de conflit. Je demande les critères de montage lorsque des organismes internationaux confirment des niveaux d’urgence. Je demande à la Municipalité de Lausanne son calendrier d’enquête, avec des jalons, des responsables, une portée définie, et l’engagement de publier l’intégralité des conclusions, sous réserve des données sensibles des victimes. Je demande aussi que le Conseil communal ou l’instance cantonale compétente fixe des auditions publiques avec des spécialistes indépendants de l’usage de la force et de la non-discrimination.
Je souhaite enfin un accès aux registres, ordres de service, comptes rendus et échanges nécessaires à la reconstruction de la séquence qui précède la mort de l’adolescent. Si la loi empêche une transmission complète, j’exige des versions caviardées qui rendent possible le contrôle social sans compromettre la cause. Ce n’est pas un caprice, c’est le prix d’une démocratie adulte qui n’a rien à craindre de la lumière.
Voix qui comptent
Les citations ne remplacent pas les faits, elles les encadrent. Gaitán a rappelé une vérité nue, le peuple est supérieur à ses dirigeants. Galeano a écrit une phrase qui ne vieillit pas, la faim est un crime. Je ne les convoque pas comme des ornements mais comme des balises. La politique s’effondre lorsqu’elle oublie les corps. L’information perd son sens lorsqu’elle se contente de l’abstraction.
Je veux entendre celles et ceux qui étaient dans la rue pendant les nuits de colère. J’écoute les familles, les commerçants, les enseignants, les agents qui refusent le racisme dans leurs rangs et qui ne supportent plus que quelques individus salissent le travail de tous. Je veux connaître aussi le récit des éditeurs qui ont décidé de montrer le premier plan d’un enfant dénutri, quelle rupture ils ont ressentie, quels doutes ils ont portés, quelles limites ils se sont imposées pour ne pas tomber dans la pornographie de la douleur. La dignité se mesure à la façon dont on montre un visage, pas à la quantité de larmes qu’on provoque.
Cadre des droits et responsabilité politique
La liberté de la presse n’est pas une excuse pour le sensationnalisme. C’est un outil au service du droit à l’information et donc du droit à la participation. L’État ne doit pas diriger la couverture ni sanctionner le contenu. Il doit informer vite, remettre des documents, se soumettre à des contrôles. Lorsqu’une administration municipale décide de suspendre des policiers en raison de messages discriminatoires, elle ouvre un chemin qui n’a de valeur que s’il conduit à la clarté, à des sanctions proportionnées et à des garanties de non-répétition. Une suspension qui ne débouche sur rien devient un simple geste cosmétique.
Sur les écrans, les standards de protection de l’enfance et de respect des victimes imposent un montage qui humanise sans exploiter. La faim ne peut pas devenir un spectacle. La scène ne vaut que si elle sert la compréhension et la mobilisation civique. Elle ne doit jamais alimenter l’indifférence cynique ni flatter le voyeurisme. Une démocratie se reconnaît à la façon dont elle regarde sa propre misère et la misère des autres.
Ce que je peux déjà affirmer et ce qui reste à vérifier
Je peux affirmer que dans la dernière semaine d’août la couverture suisse de Gaza a adopté un ton plus frontal, avec des images qui nomment la famine sans détour. Je peux affirmer qu’au même moment Lausanne est entrée dans une phase de haute sensibilité et sans précédents entre population et police, avec des nuits de trouble, des suspensions et des promesses d’enquête. Je ne peux pas affirmer qu’il existe une stratégie coordonnée pour effacer un sujet par un autre. Pour cela, il faudrait accéder à la logique de programmation et à des décisions éditoriales précises. Je ne travaille ni avec la télépathie ni avec les procès d’intention.
Je n’écris pas pour fabriquer des soupçons, j’écris pour les dissoudre. Le double écran impose une discipline double, regarder au loin sans oublier tout près, regarder tout près sans instrumentaliser le lointain. Si la télévision raconte la faim, la politique doit répondre avec des moyens et de l’urgence. Si la ville raconte l’abus ou la discrimination, la politique doit répondre avec la vérité et des conséquences. Ma pratique tient en une promesse modeste, chaque affirmation appuyée, chaque hypothèse marquée, chaque silence expliqué…
G.S.